A Paris, en plein été, le corps d’une jeune femme est repêché dans la Seine. Adèle Hème, journaliste spécialisée dans les faits divers, enquête. « Dans la peau » est le second roman noir, à plusieurs voix, de la montpelliéraine Armèle Malavallon qui explore nos monstres intérieurs.
J’ai commencé à le lire, ce thriller, dans un train, ça n’est certainement pas pour vous dire que, parce que j’ai commencé à le lire là, ce « Dans la peau » est un roman de gare, ce qui n’est pas dévalorisant en soi, les bons et les excellents romans de gare atteignent leur objectif, je pense à « Pulp », le dernier roman de Charles Bukowski : distraire du temps d’attente avant que votre TER ou votre OUIGO quittent le quai, et vous en continuerez sa lecture durant votre voyage, parce que, bon sang, ils vous ont agrippé(e), cette histoire, ces personnages !
Depuis longtemps, les personnages féminins ayant à faire avec un destin un peu pénible me fascinent, la Médée, les Iphigénie, entre Aulide et Tauride, la Buffy tueuse de vampires, les Antonia de « Le Moine » de Matthew Gregory Lewis, la Justine sadienne, les différentes versions d’Ellen Ripley, Eve, oui, quand même, Eve, la toute première. J’ai trouvé une sacrée femme de papier, au fil des pages de « Dans la peau ».
Le contenu du polar dont je vous parle, polar, terme générique pour le genre, est racé comme un lévrier à poil ras, un grand beau chien gris. Un lévrier qui, à la différence des petits lévriers aux yeux gris mouillés, ne tremble pas sur ses pattes, au moindre souffle soufflé sur ses côtes fines et saillantes. Comme ces animaux de course, le style de la romancière a du style; parce que sans longueur et vous frappant le neurone à la vitesse d’une vie où tout s’accélère, ses phrases ont pourtant l’air d’avoir eu le temps d’être comptées, comptées, pesées, et divisées, mené, mené, tekel, upharsin, comme on le lit, quelque part, dans l’« Ancien Testament », du côté de « Daniel, 5:25 ». Il faut que ça avance. L’ennui est évité avec savoir-faire.
Quatrième de couverture, extrait : « Paris, en plein été. Le corps d’une jeune femme non identifiée est repêché dans la Seine. Adèle Hème, journaliste spécialisée dans les faits divers, est en pleine rupture sentimentale quand elle tombe sur cette information a priori anodine ».
Armèle n’est pas journaliste, elle est vétérinaire. C’est son second roman noir. Elle a travaillé sur les maladies infectieuses ; que c’est intéressant, cette information, quand on y repense, après avoir fini son livre qui a le mérite de distiller, comme tout roman à saveur bien noire comme un café très serré, une amertume propre aux choses de la vie qui vont où elles doivent aller ; mais, dans le cas du roman noir, c’est de travers. C’est ça aussi, le tragique. Ce qu’on sait aller de traviole et par des détours, des chemins détournés, et qui, on s’en rend compte à l’heure du bilan, est allé pourtant tout droit vers son but, comme il fallait que ça aille, du point a au point b, avec l’infection qui va avec, celle d’être tout connement humain, celle d’avoir, justement, des travers, des obscurités, comme tout un chacun ; nous portons toutes et tous une infection qui risque de se répandre. C’est ce qui s’appelle le mal.
Et le mal prend bien des formes. Là, le corps noyé, déformé, délavé, très abîmé, d’une victime de sexe féminin dont les chairs seront autopsiées par un médecin légiste qui dira : « Je n’ai pas envie de lui couper les mains à cette pauvre petite ». Bernard Manton, c’est le médecin légiste, « reprend son exposé tout en inspectant avec minutie chaque parcelle de peau, de chair ou d’os visible sur la face postérieure du corps de la victime ». Le réalisme est gore, et c’est tant mieux, le réel du corps est parfois sale : « Vous voyez, l’arrière du crâne, le dos, les fesses, les talons, toutes ces parties du corps étaient en contact avec le sol et ont été arrachées par le frottement. (…) Le cuir chevelu a pratiquement disparu à l’arrière du crâne, le dos n’est plus qu’un magma de chairs noirâtres au milieu desquelles on devine les côtes et la colonne vertébrale, les muscles fessiers ont été arrachés et seuls quelques fragments de couleur verte persistent, accrochés aux os du bassin. Quant aux talons, ils donnent l’impression d’avoir été rabotés jusqu’à l’os ». Qui a lu mon article, publié sur Lokko, intitulé « Special : la réjouissante série sur un gay paralysé ! » connaît mon appétence pour le morbide bien disposé. Chacun de mes articles ajoute au patchwork d’une vie son bout de tissu.
La peau, l’absence de l’épiderme et du derme sont capitales dans le thriller. Au moment même où son esprit va basculer, Adèle commence un travail sur son corps. Elle se fait faire un tatouage, dans le dos, par un certain Oscar Ortiz, un tatoueur de renom, un artiste d’exception. Un artiste aussi précis et amoureux de son métier que l’artiste de la découpe qu’est le médecin légiste de tout à l’heure.
Au début de ma lecture, j’ai cru qu’Ortiz était le psy d’Adèle. Travailler la peau, travailler l’âme, choses mêmes, finalement. Grâce à la manière dont Armèle Malavallon présente et plante son personnage, j’avais oublié qu’Oscar Ortiz est tatoueur. Pour moi, il est le psychothérapeute bienveillant d’Adèle. L’écrivaine, dans sa Note au lecteur finale, nous apprend que « le personnage d’Oscar Ortiz existe. Il s’appelle Oscar Astiz. (…) C’est mon tatoueur. Etrange, la jeune femme de la Seine a, dans le dos, elle aussi, un tatouage. Vertige et labyrinthe du double encore : par exemple, lorsqu’apparaît le nom d’une émission radiophonique sur France Culture, Du chien sans l’faire exprès. Cette émission n’est pas diffusée, en vrai, sur France Culture, mais elle l’a été sur Radio Clapas, Montpellier. Elle n’existe plus aujourd’hui. Armèle faisait partie du groupe des 3 animatrices avec Sylvie Lefrère et Maud Saintin. Maud est aussi un prénom qui est présent dans le roman. Maud Saintin, romancière aussi, est remerciée à la fin du livre. Clins d’œil.
Labyrinthe et vertige des détails. Le plaisir de lire un thriller, c’est de se forcer à faire attention aux détails que le cerveau vous fait naturellement oublier au fur et à mesure d’une lecture enthousiaste, d’une lecture d’un roman qui happe. Ce qui est le cas de « Dans la peau ». La lecture du livre achevée, bien entendu, vous revenez en arrière, comme on revient sur ses pas par un temps de neige qui masque le paysage, et vous pensez à ce que vous avez lu depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours : ah, oui, ça y était, je n’y ai pas prêté attention, pourtant c’était là, sous mes yeux, une évidence, un indice voyant, dans le genre de « La lettre volée » d’Edgar Allan Poe. « Dans la peau », néanmoins, n’est pas un roman d’enquête, Sherlock, Hercule Poirot, Miss Marple ne sont pas de la partie : ce n’est pas une piste de chasse vers l’assassin à démasquer, non, non, non. Vous voilà prévenue et prévenu.
C’est aussi ça, « Dans la peau », finalement, la narration d’une infection présente déjà en chacun(e) de nous et qui se développe, quelque chose de moyennement ragoûtant, d’humain, et qui s’attaque, cette maladie qui se propage, à tant de choses que nous affectionnons malgré nous et par nous, être dupes des autres, certes, on l’est quasiment toujours, et être dupes, principalement, de nous-mêmes, de nos raisons et déraisons. Adèle s’en va son chemin de traviole dans l’obsession que lui distille, dans la cervelle, son enquête sur la mort d’une inconnue qui, bientôt, dans un des chapitres, aura un patronyme ; Adèle poussera le risque jusqu’à s’identifier parfois à elle ; quand votre nom, Adèle Hème, donne Adèle H., la fille enfermée de Victor Hugo, est-ce que votre nom et votre histoire personnelle vous mèneront aussi vers la folie ? Moi, j’ai voulu savoir. J’ai lu.
Tous les personnages du roman ne sont pas indemnes d’une vieille douleur qui les dépasse et les agite comme des marionnettes, un peu comme vous et moi. Un monde où rien n’est tout blanc, rien n’est tout noir ; et gris, ce n’est pas certain. Chacune et chacun peuvent être perdus ou en voie de rédemption, c’est le but de tout labyrinthe et de toute mosaïque : on ne sait pas où on va. « Dans la peau » est labyrinthe et mosaïque, circulaires de surcroît, l’histoire se replie sur elle-même, de peau à peau, de dessin à destin, le premier chapitre sur un des derniers ; la métempsycose advient. « Dans la peau » flirterait-il avec le surnaturel ?
Et quand la confusion de l’amour s’en mêle ? Ça se gratine, c’est clair : Adèle vient de se faire plaquer par son patron, un Anglais marié et père de famille, c’est Graham Blunt, plus âgé qu’elle, il dirige le journal dans lequel Adèle s’occupe des faits divers. Adèle est fortement remuée, fragilisée par cette rupture, rudement fragilisée, elle est folle amoureuse de cet homme ; Adèle n’a toutefois pas lâché son aventure sexuelle et sentimentale, en pointillés toutefois, avec le viril Jérôme, un ex, un enquêteur de la Criminelle, Fasten de son nom de famille, un mec avec qui elle couche, ci et là, depuis deux décennies, moins distingué que le Britannique, il a quelque chose dont elle semble ne pouvoir se passer. A lire Madame Malavallon, je me dis : « Pétard, c’est vraiment pas facile, la vie sexuelle et sentimentale des gens avec fêlures ! » Quel méli-mélo.
Le corps décomposé de l’inconnue du Canal Saint-Martin, symbolise-t-il son propre abandon amoureux, la fin ridicule de son histoire avec Graham ? Le grotesque des fins d’histoire d’amour, nous avons, toutes et tous, plus ou moins, une certaine idée de l’affaire. Au fil des pages, il n’y a pas que du grotesque amour, il y a aussi de l’ambivalent : le roman est régulièrement tremblé par des moments de répulsions, le fameux passage du soupeur des pissotières, mais aussi de chairs désirantes/désirées et/ou refusées.
Dans le roman, presque tous les personnages n’arrivent pas à se trouver, à se rencontrer complètement, pas à se quitter aussi -jusqu’à ce qu’arrive le point de rupture. Pas celui de la rupture amoureuse. Quelque chose qui met véritablement en danger. Pourtant, l’amour, c’est aussi l’un des thèmes principaux du roman. C’est quoi, l’amour ? Ça devrait faire du bien, l’amour, non ? Mais l’amour, chez Malavallon, ce n’est pas le romantisme à base de pâquerettes que l’on effeuille comme on effeuille, tout penauds et timides, les corps habillés qui provoquent une érection ou la montée de l’humidité entre les jambes.
Comme un lévrier lancé sur la piste, il faut que ça avance, la narration, placer les personnages, jeter qui la lit, cette narration, dans le courant faussement linéaire et turbulent de l’intrigue gros, ici, clin d’œil à l’intrigue de « Dans la peau » puisque, comme écrit plus haut, un cadavre de femme est retrouvé dans l’eau de la Seine du côté du canal Saint-Martin. Ça commence comme ça, le livre, dans la tête et les jambes d’un personnage féminin anonyme passant le pont des Arts, c’est Paname, la tête ailleurs et les jambes et tout le reste du corps bientôt ailleurs aussi. La femme disparaît. Plouf sans doute, le fleuve est à proximité. Fasten est chargé de l’enquête. Adèle va le suivre.
Adèle Hème (aime ? M comme dans Mort, Maladie, Malédiction, Malentendu ?) et lui ont l’habitude de travailler ensemble, elle, pour rendre compte, au lectorat du journal de Graham, des faits divers de la capitale ; lui, pour qu’éclate la vérité policière. On sait bien que la vérité, c’est ben ben ben compliqué à faire sortir de sa cachette, la vérité. On sait bien que rien n’est simple et linéaire, et encore moins la psyché des gens, proches ou non, ceux que l’on pense connaître et les autres. Tout comme le psychisme, le roman d’Armèle Malavallon est une mosaïque de points de vue et de voix : ceux de la noyée, ceux d’Adèle, ceux de Jérôme, une parole mystérieuse entrelarde le roman. Un subconscient à livre ouvert ? Un roman-panoptique dirigé vers la conscience humaine.
Jérôme, l’amant viril, l’homme qui protège, sauve, remet de l’ordre malgré le chaos, hé bien, il devient de plus en plus violent. Adèle se donne à lui tout en s’éloignant, quand lui ne veut pas se retirer d’elle -jusqu’au sens sexuel et pénien du verbe. Jérôme Fasten : to fasten, en anglais, signifie boucler, comme on boucle sa ceinture dans la voiture ou dans l’avion, pas mal pour un flic, ce ‘boucler’, pas mal pour un homme qui aime embrasser, c’est-à-dire : encercler de ses bras la femme qu’il désire et qui prend la tangente, le chemin de traverse. Jérôme a vraiment du mal à voir que son amour lui échappe. Dans un épisode de pissotières se déroulant dans un bar, un épisode faisant intervenir un soupeur, ivre d’alcool et de misère sentimentale, Fasten casse la gueule à un obèse paraphile survolté et titanesque, il lui défonce la tronche jusqu’au déchaînement et l’hôpital, et le coma pour le pauvre soupeur, une victime, une vraie victime, « la seule du roman, peut-être », me dira Armèle. Pauvre soupeur qui ne mérite pas son sort. Il a des mœurs et de désirs bizarres ; et alors ? Pourquoi cette violence, chez le flic, et qui grandit au fur et à mesure qu’avance le tatouage dans le dos d’Adèle ?
Je finis.
J’ai fini le thriller dans mon lit, ce devait être 2 heures du matin.
Je voulais savoir. J’ai su. Je me suis dit que, punaise, c’est aussi ça, le tragique, c’est la banalité de l’extraordinaire qui vous fiche son coup de poing dans la gueule et le ventre, avec lenteur et précision. C’est un compliment pour la romancière. Après « Dans la peau », on voudrait se débarrasser de l’amour.
Je termine.
Mettons ici un mot savant, celui de polysémie.
« Dans la peau », question d’amour, question de sexe, être habité(e), être tatoué(e), quoi d’autre encore ? C’est un titre tout en ambiguïté comme les forces qui bâtissent et tissent les romans noirs. Armèle m’envoie un message sur Facebook, oui, nous nous connaissons un peu, elle et moi : « Tu as encore à découvrir, mais je peux te dire que j’ai voulu parler du monstre intérieur qu’il y a en chacun, le monde est tout sauf manichéen, il n’y a pas les méchants d’un côté et les gentils de l’autre ». Lectrices et lecteurs potentiels de l’ouvrage, prenez-en bonne note.
Et apprenez que le réconfort vient des chats.
Dans la peau, Armèle Malavallon, éditions Ramsay, 19 euros.
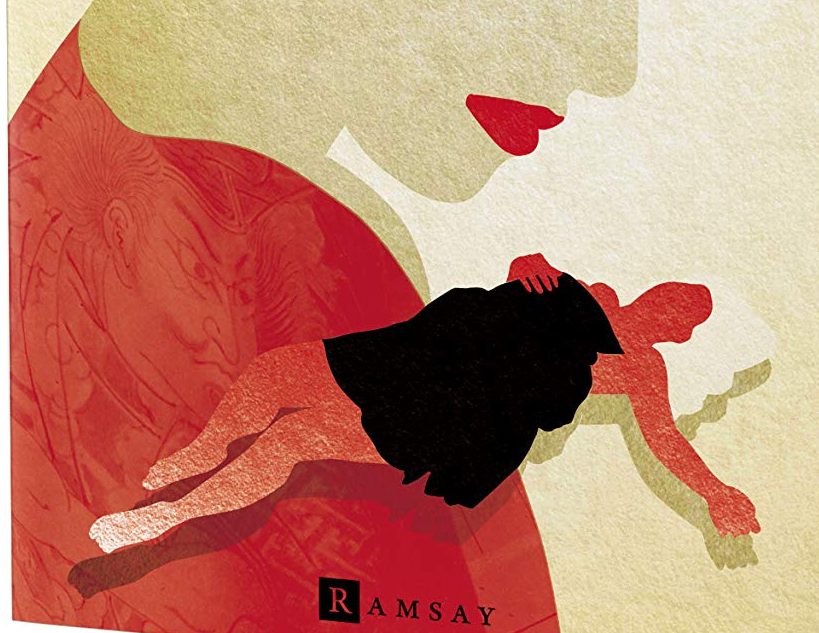





[…] https://www.lokko.fr/2019/05/18/armele-malavallon-le-polar-dans-la-peau/ […]