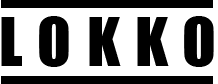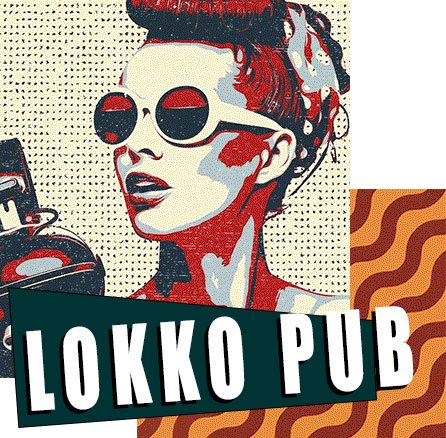L’actualité éclairée par la recherche : des rencontres «TU PARLES CHARLES» co-produites par l’université Paul Valéry et LOKKO. Le 30 avril, sur le thème «La légalisation, seule solution ?», Valérie Hernandez interviewait Yann Bisiou (*), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université Paul Valéry, un des meilleurs experts français des politiques publiques en matière de toxicomanie.
900 000 consommateurs quotidiens de cannabis, 6 millions de consommateurs réguliers. Plus d’1 million de consommateurs de cocaïne : une drogue en plein boom, bien implantée à Montpellier. 400 drogues différentes répertoriées en France. Toutes les couches de la population sont concernées. Mais on assiste plutôt à un vieillissement des usagers.
Fait social majeur, l’usage des drogues fait l’objet en France d’un débat houleux. Selon Yann Bisiou, la longue succession de lois d’exception à la française dans un contexte de dramatisation du narcotrafic est contre-performante.
Il s’alarme du caractère liberticide de la proposition de loi du Sénat contre le narcotrafic, votée le 1er avril dernier par les députés, qui prévoit un parquet spécialisé, crée un statut du repenti, et aménage des quartiers de haute sécurité.
Sa référence : le Canada, qui a choisi la légalisation, passe des appels d’offres pour la fabrication des drogues, qui sont ensuite vendues dans des magasins d’état.

LOKKO : Yann Bisiou, nous avons donné ensemble ce titre à cette rencontre : «La légalisation, seule solution ?» mais vous auriez enlevé le point d’interrogation, si cela n’avait tenu qu’à vous, tant vous défendez avec constance la nécessité d’un changement de stratégie en matière de toxicomanie. Nous nous situons plus que jamais dans une actualité brûlante, avec le vote, hier, de la proposition de loi d’origine sénatoriale visant à lutter contre le narcotrafic, définitivement adoptée à 396 voix pour et 68 contre. Un succès pour les ministres de la Justice et de l’intérieur, Gérard Darmanin et Bruno Retailleau, qui l’avaient portée. Quel est votre sentiment à ce stade ?
YANN BISIOU : C’est une particularité en matière de stups : on fait beaucoup de lois. En moyenne, une nouvelle loi tous les six mois depuis 54 ans. Et à chaque fois, on va renforcer la répression. Je vais être très critique sur celle-ci. C’est un succès, mais un succès modéré. Habituellement, les lois en matière de drogues sont votées à l’unanimité. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé au Sénat. Hier, à l’Assemblée nationale, il y a eu quand même eu une petite réaction hostile.
Une loi liberticide
Cette loi a pour moi deux inconvénients majeurs. Le premier est qu’elle rate son objectif : elle ne permettra pas de lutter contre le narcotrafic et donc de réduire la consommation de drogue en France. Elle est inefficace mais aussi liberticide. Elle porte atteinte de façon extrêmement importante aux libertés fondamentales. C’est la seule loi -et la première loi visant le trafic de drogues- à susciter un recours au Conseil constitutionnel. Comme ces lois sont votées à l’unanimité, elles ne font pas l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, donc il existe très peu de décisions de cette instance en matière de stups. Les quartiers de haute sécurité, supprimés par Badinter, risquent d’être attaqués.
On voit bien que le narcotrafic a flambé, qu’il s’agit d’une réalité d’une gravité extrême. Le rapporteur socialiste a d’ailleurs validé cette loi. Sur un parquet spécial s’est dégagé un consensus. Ne fallait-il pas renforcer l’arsenal pénal ?
Initiée par Les républicains, une commission d’enquête a débouché sur la rédaction de la loi co-signée en effet, avec le Parti socialiste. C’est la France insoumise qui s’y est opposée, et quatre députés écologistes, les autres s’étant abstenus.
Mais regardons quelques points assez spectaculaires : le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) existait déjà. Le même schéma se répète : on nous annonce à chaque fois qu’il faut un créer une structure spécialisée, lui donner des moyens exceptionnels. Il y avait eu d’autres organismes de ce genre comme l’Office anti-stupéfiants (OFAST) ou l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), et, avant cela, les «Superflics» affectés au démantèlement des filières de l’argent de la drogue, du temps de Pierre Joxe, en 1989. Des modèles qui trouvent leur origine dans les années 50 avec la DEA américaine (Drug Enforcement Administration), excessivement critiquée pour ses échecs aux Etats-Unis où l’on a complètement raté la crise des opioïdes. Et surtout, un modèle qui ne correspond plus à la réalité du trafic.
Le trafic a muté
Ce que je constate, c’est que jusqu’à présent, à chaque fois qu’on a fait un dispositif spécial et qu’on a affecté des moyens spéciaux, on n’a pas baissé la consommation de drogue. En quoi ce parquet national sera-t-il plus fort ? Aujourd’hui, le trafic a muté. Il s’est transformé et cela, la loi ne l’a pas du tout abordé. On ne sera jamais capable de contrôler, de contrôler de façon absolue, puisque c’est cela l’idée. Compte tenu des moyens dont disposent les trafiquants, ils arriveront toujours à contourner le système. Là où je rejoins Bruno Retailleau pour le coup, c’est de situer l’enjeu du trafic sur son économie et ses moyens.
Parmi les aspects spectaculaires, il y a le recours aux renseignements algorithmiques, c’est à dire qu’on va faire de l’analyse massive de données comme pour le terrorisme. C’est une nouveauté. Également, les IMSI-catcher, ces boîtiers qui vont récupérer des données numériques dans un rayon de quelques dizaines ou centaines de mètres. Quand vous passez en voiture, l’IMSI-catcher enregistre vos données que la Police va analyser ensuite pour avoir une connaissance très fine de la vie d’un territoire. Des données souvent intéressantes et utiles.
On prévoit de la surveillance à distance des téléphones, mais on exclut du dispositif les députés, les journalistes alors qu’on sait bien que les atteintes à la presse se sont spécialement développées sous Macron.
Et encore… Lorsque j’ai été auditionné à l’Assemblée nationale par la commission d’enquête, un enquêteur nous a expliqué comment ça se passe. Dans une grande ville du sud de la France très connue qui n’est pas la nôtre, on écoute tout, y compris lorsque l’on tombe sur une écoute qui ne peut pas être enregistrée, qu’on classe alors en tant que témoignage anonyme…
Les informateurs : une tradition dangereuse
Le régime des repentis renforcé : cela veut dire quoi exactement ? Est-ce que ça marche ?
Pour la défense de cette loi, on nous a dit qu’il y avait des choses merveilleuses ailleurs. On nous a cité deux exemples : les repentis en Italie et le dossier-coffre en Belgique. Au même moment, la presse italienne parlait de l’arrestation de plus d’une centaine de criminels. La mafia en Italie s’est reconstituée. Les repentis, ça a marché pour faire tomber la Camorra à un moment donné, mais ça n’a même pas atténué le trafic.
Le dossier-coffre, c’est la même chose. Quand on nous expliquait que c’était tout aussi merveilleux, au même moment, la presse belge faisait le diagnostic d’un échec complet de la politique belge de lutte contre le trafic de drogue.
C’est quoi un dossier-coffre ?
C’est une technique qui va limiter la communication à l’avocat des informations contenues dans une enquête afin de protéger l’anonymat des témoins, de protéger les méthodes d’enquête. Mais cela n’a pas fonctionné en Belgique, et pas davantage le statut d’infiltré civil, c’est à dire d’informateurs rémunérés. Une solution venue des USA. Dans les faits, le statut de l’informateur crée un risque pour les policiers et un risque pour l’institution. Il y a eu une affaire célèbre en France avec l’ancien directeur de l’OCRTIS, donc de la Brigade des Stups, manipulé par son informateur. L’informateur est une grande tradition dans l’enquête policière, et, en même temps, c’est très dangereux.
On va revenir sur les mesures «liberticides». Nous avons parlé en amont de cette rencontre de la «déjudiciarisation» de la lutte contre le narcotrafic. D’une extension des pouvoirs de la Police notamment.
Le juge, c’est le protecteur des libertés fondamentales, des libertés individuelles, dont il est le garant. En retirant de plus en plus de prérogatives aux juges pour les transférer au pouvoir exécutif, vous embolisez le système pour le rendre soi-disant plus efficace.
Une mesure m’a profondément choqué dans cette loi : c’est la possibilité pour un Préfet de fermer pendant six mois une structure ouverte au public sur le simple fait qu’elle serait «susceptible» de favoriser le trafic ou le recel. C’est la porte ouverte à l’arbitraire. Il y avait déjà des possibilités de fermeture administrative en matière de stups, notamment des restaurants, des bars etc. Là, on l’étend en ciblant les associations, en particulier les structures de quartier, qui animent la vie sociale et ont, parfois, des liens avec la drogue avec des jeunes qui vont grenouiller un peu dans le trafic. Auparavant, il fallait établir un lien entre l’établissement et l’infraction. Désormais, on parle seulement d’une connexion « susceptible » avec le milieu de la drogue.
Fermer les épiceries n’est pas efficace
Il y a un point de fixation dans le débat public à Montpellier sur les commerces, porté énergiquement par le maire de Montpellier où l’on préempte, on rachète des lieux qu’on soupçonne de blanchiment. Des épiceries, des bars à chichas en particulier. Le Rassemblement national voulait que ce soient les maires qui puissent prendre cette décision, visiblement la nouvelle loi ne le permettra pas. Vous avez été consulté, je crois, par Michaël Delafosse.
Cette question est essentiellement liée au protoxyde d’azote qui n’est pas catégorisé comme stupéfiant en France, même s’il pose un problème réel de santé publique. C’est un produit pour lequel on a inventé un statut sur mesure en tant que produit d’usage courant susceptible de détournement psychotropes.
Ensuite, il s’agit de micro-blanchiment, c’est à dire que les « commerçants » vont gonfler leur chiffre d’affaires. D’habitude, ils essaient de frauder en sous-estimant leur chiffre d’affaires et en ne déclarant pas tout. Là, on fait l’inverse : on déclare des sommes qu’on n’a jamais reçues puisqu’elles viennent du deal, en payant des impôts en conséquence. Le problème a commencé, dit-on, avec les épiceries de nuit mais si vous fermez les épiceries, le trafic trouvera un autre type de commerce. Le volume d’argent est tel que ce ne sera pas efficace. Je l’ai dit au maire de Montpellier. Je le dis à tout le monde.
Les trafiquants sont des ultra-capitalistes
Nous devons d’abord réduire la disponibilité financière dont disposent les trafiquants. C’est impératif. L’agence française chargée des saisies des confiscations obtient des résultats remarquables, mais œuvre dans un rapport de 1 à 10 de la valeur du trafic. Les trafiquants sont des ultra-capitalistes. C’est un capitalisme sans frein, sans règle, sans foi, sans loi, donc à un moment donné, si vous voulez faire quelque chose, il faut agir sur l’argent. Et là, on y est pas.
Le trafic s’est profondément transformé ces dernières années. Or, tout notre système est basé sur l’idée de mafia, c’est-à-dire un système hiérarchique avec un chef, des lieutenants. Une organisation très structurée, très hiérarchique. Ce que nous montrent les travaux, par exemple d’Europol, l’agence policière européenne, c’est que le trafic s’est diversifié dans ses techniques et ses méthodes. Le cannabis, il y a 20 ans -le haschich- venait du Maroc. Aujourd’hui, c’est d’abord de l’herbe qui est essentiellement produite en Europe. L’autoculture, marginale il y a quelques années, représente 40% de la consommation. Les consommateurs d’herbe la cultivent eux-mêmes.
On peut parler aussi de l’ubérisation du trafic, ce qu’on appelle l’ »Uber Shit ».
Lors de mon audition par la Commission d’enquête, j’ai montré tous les tweets que je recevais après avoir posté des messages sur Twitter sur la drogue. Des dizaines d’offres pour me connecter à Telegram et acheter à des prix imbattables. Toutes les substances du monde. Les enquêteurs sont tombés de l’armoire. C’est ça l’ubérisation.
Il était prévu à l’origine qu’on puisse espionner les conversations sur WhatsApp, une préconisation qui ne figure pas dans la loi.
C’était très liberticide pour le coup. Il paraît que beaucoup de choses se passent sur WhatsApp, mais c’est attraper des mouches avec des gants de boxe. Toujours ce problème de proportionnalité.
La dernière mutation, qui est pour moi la plus préoccupante, c’est le fait que le trafic soit de moins en moins hiérarchisé. Les malfaiteurs vont se réunir ponctuellement dans le cadre d’une opportunité de trafic, puis, ensuite, ils vont se séparer. L’exemple de Mohamed Amra est très illustratif. Il est passé sous les radars parce que son groupe n’était pas homogène.
L’équivalent des loups solitaires dans le terrorisme ?
D’une meute ! Ce caractère nébuleux, la loi ne l’a pas envisagé.
La police de proximité était un outil
Quelle est la solution alors ?
On me pose souvent la question. Je ne suis pas un spécialiste de la Police, je suis un spécialiste des stups. Mais je pense que la police de proximité était un outil pour ce genre de choses car elle permettait une connaissance précise du territoire criminel.
Quand nous avons préparé cette émission, vous aviez parlé d’une dramatisation du narcotrafic et cela m’avait un peu surprise. On a tous eu ces récits d’enfants marchant sur des seringues. On dit que le cartel de la DZ Mafia est désormais implanté à Montpellier. En gros, le narcotrafic s’est quand même terriblement amplifié.
C’est vrai : il y a plus de trafic, il y a plus d’offres, il y a plus de demandes. C’est là où je parle d’échec de la prohibition. Des records sont battus. Les ministères de l’intérieur et de la Justice communiquent toujours sur deux chiffres : les interpellations, et les saisies. En fait, ce sont seulement des indicateurs de réussite du trafic. Ils sont insuffisants.
Les chiffres qui vous donnent une véritable vision du problème de la drogue, c’est ce que j’appelle les trois P. C’est la prévalence : le nombre de consommateurs par rapport à la population générale. Le deuxième, c’est le prix. À part l’herbe, on est soit sur une stabilité soit sur une baisse des prix, voire une baisse très forte pour la cocaïne en euros constants. C’est un marché concurrentiel : on ne peut pas se permettre de vendre cher sinon les clients vont ailleurs. Le troisième indicateur, c’est la pureté. Plus le produit est pur, plus le trafic est florissant.
À partir de ces critères-là, et si on regarde les derniers chiffres-clé de l’Office français des drogues et des toxicomanies, on voit que jamais la drogue n’a été aussi présente en France et en Europe.
En France, l’obsession du cannabis
Venons-en aux consommateurs, les grands oubliés de cette loi. Vous avez donné des chiffres qui sont assez vertigineux : 21 millions de personnes ont essayé au moins une fois de fumer du cannabis, 5 millions de Français ont fumé dans l’année de manière sûre, 900.000 consommateurs quotidiens de cannabis, 600.000 consommateurs réguliers de cocaïne, donc beaucoup plus de consommateurs occasionnels.
En France, on est des obsessionnels du cannabis.
Pourquoi ?
Difficile à dire, je peux émettre des hypothèses. On avait un marché très organisé entre le Maroc et la France qui fonctionnait très bien, donc c’était simple de s’en procurer. La production des amphétamines et des drogues de synthèse était plutôt liée au nord de l’Europe. Cette mono-consommation quasiment centrée sur le cannabis est spécifiquement française. En Angleterre, vous avez une diversification beaucoup plus grande : cannabis, cocaïne, et ce qu’on appelle les «new psychoactive substances».
Mais avec, quand même, une consommation en hausse de la cocaïne.
Il faut la relativiser avec 600.000 usagers qui consomment dans le mois.
400 drogues catégorisées, c’est considérable !
C’est énorme, on en classe encore des nouvelles. Tous les ans, je vois passer des choses qu’on dit à la mode mais qui échappent à la plupart des modes traditionnels de détection. La plupart de ces produits ne sont pas consommés.
Les produits pour lesquels, on a un problème social de consommation, c’est en gros le cannabis, et la cocaïne. Je ne compte pas les nouvelles substances psychoactives parce que c’est très faible, ni l’héroïne qui ne représente plus les mêmes enjeux sanitaires. Elle est mieux gérée qu’auparavant. Les autres, ce sont des micro-consommations comme les champignons hallucinogènes.
Je veux aussi une société sans drogue
Doit-on faire de la drogue, une lecture sociale ? Dans la seringue se concentrerait les poisons de tous nos maux, de nos crises : de l’immigration à l’école, de l’autorité dégradée jusqu’aux questions d’identité.
Non, non, la drogue est juste un problème. Ce n’est pas quelque chose qu’il faut promouvoir. Moi, dans ma réflexion, je ne cherche pas un modèle complaisant. J’ai le même objectif que Retailleau mais pas les mêmes moyens et pas les mêmes valeurs… Je veux aussi une société sans drogue, ce serait merveilleux à priori.
Plus qu’un fait social, ou un fait politique, la drogue est un fait sanitaire. Et ce que je déplore, c’est qu’il n’y a aucune approche sanitaire de la toxicomanie. La réduction des risques, qui a été une réussite à une époque, et a sauvé des centaines ou des milliers de gens du sida, s’est d’abord construite avec les usagers, les personnes séropositives qui se sont mobilisées pour imposer une politique à l’état. Mais on est aujourd’hui à l’agonie. Il n’y a plus d’ambition, il n’y a plus de volonté. On a même renoncé au cannabis thérapeutique. L’objectif des politiques publiques de la drogue doit être la santé publique, pas la sécurité publique. Et ça, on l’a perdu complètement de vue.
La drogue, c’est pas bon, c’est dangereux. Tout le monde est d’accord. Si vous expliquez qu’en l’interdisant, on va aggraver le problème, c’est plus compliqué. La France n’est pas la seule. La plupart des pays en sont à ce stade. On a actuellement au niveau international deux modèles : la prohibition telle qu’on l’a connue depuis les années 70. Un échec partout. Une partie des pays sont allés vers la légalisation et l’autre vers une ultra-répression. L’Asie notamment avec Rodrigo Duterte, le chef d’état philippin, dans les geôles maintenant de la Cour pénale internationale, coupable de milliers d’exécutions extrajudiciaires. Ou les processus d’exclusion sociale des usagers en Chine. Ou encore la peine de mort pour les trafiquants en Corée du Sud.
En France, que risque-t-on ?
Une amende de 3.750€ et, en théorie, un an d’emprisonnement pour l’usage de stupéfiants. Un tiers des condamnés s’acquitte de cette amende, la population ciblée étant en partie insolvable.
Au Canada, une légalisation sanitaire
Venons-en au modèle canadien pour que l’on comprenne bien ce que vous préconisez. C’est votre référence.
Alors, peut-être, un mot pour ceux qui ne connaissent pas le sujet : on parle de légalisation, de dépénalisation et de prohibition. Dans ce dernier cas, c’est une interdiction pure et simple. Pour la dépénalisation, le commerce est interdit, la consommation est interdite, mais les sanctions sont seulement administratives, et non pénales. Dans le cas de la légalisation, le produit est en libre disposition. Il y a deux grands modèles qui m’ont intéressé : le modèle américain, relevant du capitalisme pur et dur. Le cannabis est un produit comme les autres.
Le Canada a fait un choix différent, en choisissant «une légalisation à vocation sanitaire». L’objectif a été de faire une concurrence directe aux trafiquants. A Québec, ils ont instauré un pur monopole d’état, c’est à dire que c’est l’état, à travers une société qui s’appelle la Société québécoise du cannabis, qui vend le cannabis. Le résultat est impressionnant : 70% du cannabis acheté à Québec provient de la SQC qui le vend dans ses magasins. Des licences sont attribuées après des appels à projets. L’état définit les qualités des substances et ça marche très bien.
Est-ce que cela a éradiqué le trafic ?
Les produits vendus par l’état étant moins dosés, les gros consommateurs continuent à avoir recours au trafic, même si on trouve sur le marché public du cannabis à 10% de THC ce qui est assez élevé.
Que fait l’état québécois de tout cet argent venu de la drogue ?
Là encore, c’est une spécificité québécoise : ils ont investi massivement cet argent dans la prévention et multiplient les initiatives. Par exemple, ils font du phoning auprès des consommateurs pour les informer des risques de la conduite quand on a consommé du cannabis.
On vend le poison avec le remède ! Comment évalue-t-on le risque d’augmentation de la consommation ?
On constate une augmentation de la consommation occasionnelle -dans une soirée, un joint circulera plus facilement- mais pas pour les deux catégories-clé : les consommateurs réguliers problématiques et les jeunes. On a même constaté une baisse de consommation chez les jeunes. Une baisse que je vois aussi en France où les usagers vieillissent. Ce qui est dû, selon moi, à un effet Covid, à un éloignement de la fête.
La persécution du CBD
Êtes-vous favorable à l’auto-production ?
Oui, c’est un moyen de casser cette logique économique dont je parlais. Il existe des Cannabis Social Club, en particulier en Espagne. C’est intéressant.
Que pensez-vous de la mode du CBD légal ?
Le CBD, ça ne fait pas beaucoup d’effet, en tout cas pas d’effets stupéfiants, mais l’administration a manifestement du mal à accepter cette idée, et donc il y a actuellement des poursuites massives contre les acteurs de la filière CBD alors qu’on voit des grandes entreprises au nom prestigieux vendre les mêmes produits sans que l’état n’y voit rien à redire.
La seule personne dans mon entourage qui consomme du CBD, c’est ma Tante Jeannette, 98 ans, déprimée. Son médecin l’a mise sous CBD et elle va beaucoup mieux !